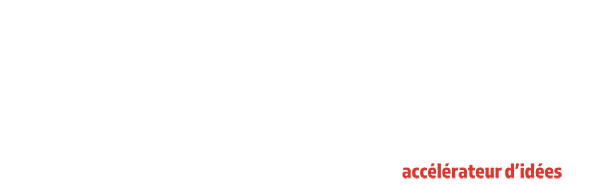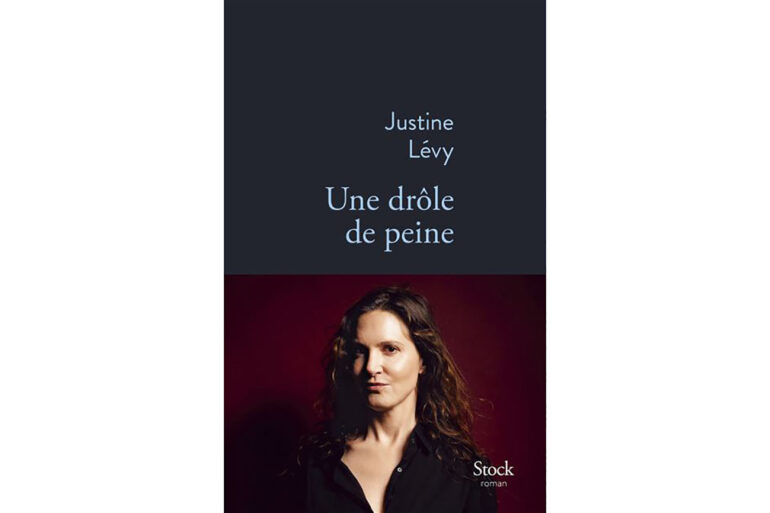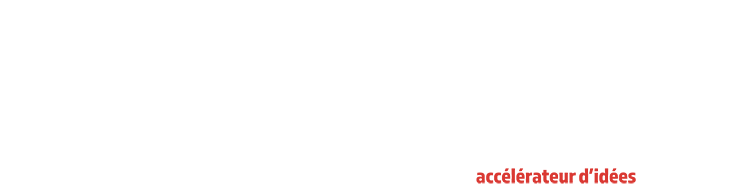Il est des livres qui n’essaient pas de clore une histoire mais de l’ouvrir, comme une plaie. Celui-ci appartient à cette catégorie rare : récit-enquête, récit exorciste, tentative désespérée d’élucider un mystère à partir de fragments. Justine Lévy ne raconte pas : elle fouille, elle retourne les décombres d’une filiation douloureuse. Ce n’est pas l’histoire d’une enfance, c’est la cartographie d’un mystère creusé par l’absence d’une mère partie trop tôt.
Tout le livre se déploie à partir de ce vide. Serge Reggiani chantait : « L’absence, la voilà. / […] L’absence / D’un enfant, d’un amour / L’absence est la même. » Et Justine écrit : « Je suis sûre que Maman s’est échappée, les mères reviennent toujours. » Deux voix qui se répondent : l’une dans la chanson, l’autre dans la littérature. Et toutes deux disent la même vérité : l’absence ne disparaît pas, elle devient une présence obsédante.
La mère, Isabelle Doutreluigne, apparaît comme une figure de la subversion malsaine en série. Mais, avant de se dissoudre dans la drogue dure, les amants, les fuites et la prison, il y eut un geste originel : celui de sa propre mère, médecin, qui lui faisait ses ordonnances. Volonté de calmer ? De taire ce qui débordait ? Ce geste presque inaugural agit telle une initiation empoisonnée.
Tout s’enchaîne, dès lors, comme une fatalité. Isabelle devient femme en portant ce poison comme héritage invisible. Son anticonformisme, brandi comme un drapeau, n’est qu’un conformisme de la rupture. Elle répète la transgression jusqu’à l’abîme, transmettant à sa propre fille un socle fragile bâti de négligences, de rendez-vous manqués et d’abandons inconscients.
Justine, l’enfant-adulte, raconte depuis ce champ de ruines. Elle mesure plus qu’elle ne juge. Elle sait que le lien, malgré la blessure, garde sa force. Sa langue se déploie entre loyauté filiale et lucidité implacable, gravité et autodérision. « Cette bizarre enfance qu’elle m’a donnée ne m’a pas rendue spécialement gaie ni débrouillarde, mais hypocrite, oui. J’ai pris l’habitude de sourire, souffrir et sourire, être révoltée et sourire, tomber à l’intérieur de moi mais sourire », écrit-elle.
La force de son texte est de refuser la résolution. Pas de récit linéaire, pas de confort narratif. Justine écrit en spirale, dans l’inachevé de ces enfants qui n’ont jamais été enfants et qui portent le fardeau d’adultes refusant la responsabilité d’adultes. Certaines histoires ne convergent jamais, certaines blessures ne cicatrisent pas. Mais l’écriture invente une forme pour accueillir ce manque. Elle transforme l’absence en rythme et la douleur en récit.
Ce livre n’est pas une biographie, ni un témoignage. C’est un objet hybride : mémoire fracturée, équation impossible, partition dissonante. Une drôle de peine oscille entre récit et autofiction : Justine Lévy y transforme la matière brute de sa vie en un roman-enquête. Ici, la confession n’est pas une fin mais un outil, un scalpel. L’auteure ne raconte pas pour se livrer : elle raconte pour maintenir ouverte la question de ce qui ne se résout pas.
On referme ces pages avec la sensation d’un chantier toujours en construction. Rien n’est clos. Mais quelque chose s’est déplacé. Le lecteur devient témoin, presque complice d’une tentative de vérité.
Justine Lévy, Une drôle de peine, Stock, 2025.
Par Assiya Shabi