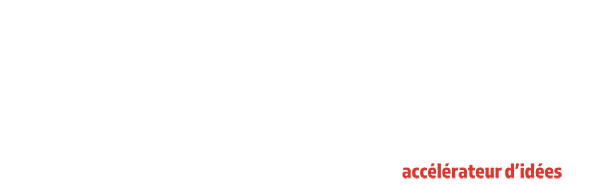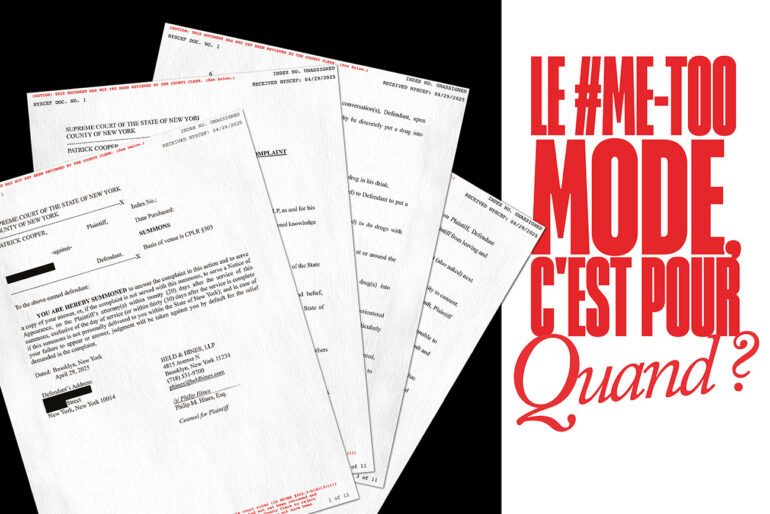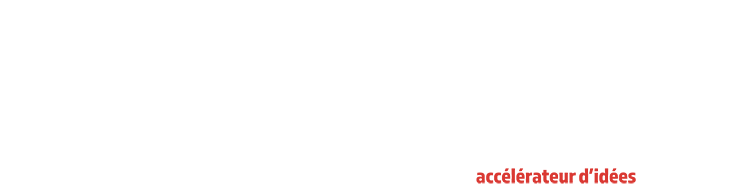Malgré de nombreuses accusations d’agressions sexuelles visant certains grands noms du milieu, l’industrie de la mode n’a toujours pas fait son #MeToo. Le journaliste le plus influent de Substack, Louis Pisano, mène l’enquête.
Légende photo : Assignation_ Les accusations suivies de procès sont rares. Voici une exception récente du tribunal de New York.
En décembre 2020, j’étais confiné à Paris, je passais mon temps à mettre à jour des applis que je n’aimais même pas, juste pour me sentir connecté. Plus de Fashion Week, plus d’afterparties, plus de voyages pros. Juste mon téléphone, un océan d’infographies Insta et Clubhouse, une appli audio addictive et bancale où, l’espace d’un instant, le monde semblait parler à haute voix.
C’est là que tout a commencé, tard dans la nuit : une salle virtuelle que je co-animais avec Darnelle Casimir et James Love. À l’ordre du jour ? « Alexander Wang : un prédateur présumé ? Il est loin d’être le seul… » Les accusations d’agressions sexuelles visant Wang venaient d’éclater au grand jour, l’ambiance était électrique. Mannequins, stylistes, journalistes, et même quelques célébrités planquées derrière des comptes anonymes, se sont joints à nous. Paper Magazine en a parlé. Pendant un temps, on pouvait penser qu’un séisme était sur le point de fissurer l’industrie. Tout le monde posait la même question : Et si c’était enfin le moment #MeToo de la mode ? Spoiler : ça ne l’a pas été.
LISTE NOIRE OFFICIEUSE
Et pourtant, je voulais que ce soit le cas. Bon sang, j’en avais besoin. On en avait tous besoin, cloîtrés dans nos appartements, exclus de nos industries, assoiffés de justice. Mais malgré l’élan, la couverture médiatique et l’indignation publique, rien ne s’est passé. Wang a publié un démenti générique, suivi plus tard d’un règlement à l’amiable et d’une sorte de non-excuse. Les marques et les célébrités qui l’avaient autrefois porté aux nues sont restées muettes. En à peine un an et demi, il organisait un défilé de retour en force à Los Angeles, avec un parterre d’étoiles. Un schéma familier : le choc, puis le silence.
À la même époque, une autre série de chuchotements numériques a fait des vagues : le compte Instagram, aujourd’hui disparu, @ShitModelMgmt. Au départ, une page satirique gérée par des mannequins, qui s’est transformée en un espace de confessions, regroupant des accusations anonymes, des captures d’écran et, finalement, une « liste noire » d’abuseurs présumés et de lieux de travail toxiques.
L’espace d’un instant, on aurait cru que la mode entrait dans l’ère de reddition des comptes. Des noms étaient lâchés. Des preuves circulaient. Les mannequins parlaient, publiquement, bruyamment. Mais, comme pour le moment Clubhouse, tout s’est essoufflé. Les menaces judiciaires ont afflué. Les gens ont pris peur, le compte a disparu… Et la plupart des noms figursny sur cette longue liste ? Ils prospèrent encore dans l’industrie.
Alors, pourquoi la mode n’a-t-elle pas eu son moment #MeToo – alors que le cinéma, la musique, les médias et même le monde de la gastronomie ont connu des bouleversements culturels majeurs ? Sûrement pour cette raison : dans la mode, les relations comptent plus que dans d’autres industries. Annonceurs, créateurs, relations publiques, médias : tout est entrelacé dans un écosystème délicat et incestueux. Un écosystème où nuire à une figure puissante peut signifier perdre ses entrées, son travail, ses financements. « Les egos sont démesurés, m’a expliqué un ancien rédacteur-en-chef du secteur. Et le financement des médias est intrinsèquement lié aux mêmes personnes que l’on critiquerait. » Ce mur invisible aurait donc empêché l’avènement d’un véritable « moment #MeToo » pour la mode.
BAS-FONDS DES CLUBS
La notoire nightlife de la mode est le ventre sombre de l’industrie. Là où le glamour des podiums rencontre les bas-fonds des clubs, où les frontières s’estompent au milieu des flashs d’appareils photo, des verres qui coulent à flots et des puissants qui s’en donnent à cœur joie, de mauvaises choses se produisent.
Bonnie El Bokeili, sélectionneuse à l’entrée d’événements où la mode et la vie nocturne se croisent, l’a dit sans détour : « J’ai vu des comportements arrogants, des gens qui dépassent les limites, consomment des drogues en public, prennent de haut le personnel. Ça arrive tout le temps. Si ça ne tenait qu’à moi, ils seraient virés comme n’importe qui d’autre. Mais dans la mode, comme dans d’autres scènes culturelles, il est difficile d’appliquer l’équité quand une personne puissante est impliquée. Les gens ont peur de prendre des risques. Ils protègent ceux qui ne le méritent pas, parce qu’ils pensent que c’est plus sûr. Parce qu’ils ne veulent pas perdre leurs accès, leurs jobs, leurs opportunités. Et donc, les comportements continuent, sans contrôle. »
Cette peur – d’être mis à l’écart, unfollowé, blacklisté – maintient le silence. Elle empêche les victimes de parler et protège les prédateurs. La mode récompense la proximité avec le pouvoir. Et, dans les heures floues après minuit, il est souvent plus facile de fermer les yeux que d’appeler quelqu’un à rendre des comptes et de risquer sa place sur la liste des invités.
LA ZONE GRISE
La mode prospère sur l’esthétique, l’alchimie, la performance. Tout le monde vend quelque chose : beauté, désir, exclusivité. Mais que se passe-t-il quand cette performance est confondue avec le consentement ? Mia Khalifa, qui a navigué dans l’hyper-visibilité du travail du sexe et le complexe médiatique, m’a dit : « L’obsession culturelle pour l’entitlement permet à certains d’ignorer les limites. Ils regardent quelqu’un et s’attendent à des choses en fonction de son apparence, de sa tenue ou de son pouvoir présumé. »
Elle a souligné comment la mode, comme le divertissement pour adultes ou la musique, repose sur des contrats opaques et des structures de pouvoir informelles qui désavantagent souvent les jeunes et les marginalisés. « Tout contrat manifestement déséquilibré constitue une dynamique de pouvoir nuisible, détaille-t-elle encore. Et il est difficile de se défendre quand ils peuvent simplement engager le prochain candidat en lice. » Ce qui nous ramène au plus grand défaut de la mode : la jetabilité. Il y a toujours un autre mannequin. Un autre assistant. Une autre muse.
« UN SECRET DE POLICHINELLE »
Quand j’ai demandé à cet ancien rédacteur en chef s’il avait déjà entendu des histoires d’abus sexuels dans la mode, et plus précisément à Paris, il a ri amèrement. « Tout le monde a entendu quelque chose. C’est un secret de polichinelle, comme à Hollywood. La différence, c’est que la mode n’a pas d’institutions conçues pour protéger les gens. Pas de SAG. Pas de syndicat. Les mannequins sont généralement freelances. Les stagiaires ne sont pas payés. Les stylistes sont des contractuels indépendants. Tout le monde est vulnérable. »
Et les rumeurs ? Elles sont infinies. Il y a ce créateur gay en vue qui aurait agressé son assistant, son nom murmuré à chaque soirée techno, mais jamais vraiment publié. Ce grand ponte des relations publiques qui a discrètement disparu d’une grande maison de luxe après plusieurs plaintes pour inconduite, pour réapparaître quelques mois plus tard en tant que consultant pour des marques plus petites. Ce directeur de casting connu pour glisser dans les DM sous prétexte de « découvrir de nouveaux visages », alors que tout le monde sait ce qu’il cherche vraiment. Alors, il ne s’agit plus seulement de savoir qui détient le pouvoir, mais de savoir qui est autorisé à franchir la ligne sans conséquence.
Il y a aussi un problème de perception. Quand des inconduites se produisent entre hommes gays, en particulier dans les espaces nocturnes, elles sont souvent minimisées ou érotisées. « Il y a cette idée que les hommes gays ne peuvent pas se violenter mutuellement », m’a confié un contact. « Que tout est mutuel. Amusant. Que ça fait partie de la culture. » Mais le mal ne disparaît pas juste parce que tout le monde est bien habillé, et l’abus ne devient pas sexy parce qu’il a lieu dans un hotspot branché.
Prenez Terry Richardson. Autrefois l’un des noms les plus sulfureux de la photographie de mode, il a finalement été lâché par Condé Nast et plusieurs grandes maisons en 2017, après plus d’une décennie d’allégations, dont beaucoup étaient détaillées, publiques et horrifiantes. Pendant un temps, il a disparu. Mais maintenant ? Il est discrètement de retour, photographiant des campagnes pour Enfants Riches Déprimés et des couvertures pour Arena Homme+. Un rappel glaçant : l’annulation dans la mode n’existe pas vraiment. C’est juste une pause. L’industrie peut mettre un nom toxique en attente, mais tôt ou tard, elle veut récupérer son esthétique.
SILENCE LUCRATIF
Dans cette salle Clubhouse en 2020, l’insider de la mode Dr. Brett Staniland se souvient d’un sentiment collectif de « enfin ». « On avait l’impression que quelque chose devait changer. Nous avions tous la même réaction face aux allégations contre Alexander Wang : du dégoût. Mais personne n’était surpris. » Il pensait que ce moment pourrait être un tournant. « On avait l’élan, des preuves, des témoins. » Mais sans soutien institutionnel, sans syndicats, sans protections légales, sans même des espaces sécurisés pour signaler, ça n’a été qu’une conversation de plus. Un autre scandale éphémère sur Internet. « Et c’est ce qui a rendu les choses pires, m’a dit Brett. Parce qu’on avait l’impression que les gens voulaient que ça change. La machine est restée la même. »
« PEUT-ÊTRE QUE TOUTE CETTE GESTION DE RÉPUTATION FORCERA LES MARQUES À CHANGER… » — MIA KHALIFA
Alors… ce #MeToo pourrait-il être pour bientôt ? Certains jours, je me dis que oui. D’autres jours, je vois un abuseur notoire réembauché, ou quelqu’un discrètement réintégré avec une campagne brillante et une place au premier rang, et je me dis : absolument pas. Peut-être sommes-nous trop loin. Peut-être le silence est-il trop lucratif.
Bonnie, la videuse de la nightlife, pense que quelque chose change lentement : « Les réseaux sociaux ont changé la donne. Ils ont aplati les structures de pouvoir. Les influenceurs et les journalistes indépendants ont dénoncé des marques, des créateurs, même des choix de tapis rouge. Les fissures apparaissent. » Même Mia Khalifa, toujours sceptique, voit un potentiel : « Peut-être que toute cette gestion de réputation forcera les marques à changer, ne serait-ce que pour éviter l’embarras. Parfois, échouer vers le haut est la seule voie à suivre. »
J’ai aussi demandé à mes abonnés Instagram : la mode pourrait-elle avoir son moment #MeToo ? Les résultats sont presque à égalité : 53 % ont dit oui, 47 % non. Cette fracture dit tout. Le moment de vérité de la mode semble à la fois inévitable et impossible, coincé entre un désir de changement et le poids de son propre silence. Car pour que la mode ait vraiment son moment #MeToo, il faudrait plus qu’une Story virale ou une salle Clubhouse. Il faudrait quelqu’un avec assez de stature pour que les gens s’en soucient, et une histoire si irréfutable que l’ignorer serait une forme de complicité.
Mais la mode n’a jamais été conçue pour protéger les vulnérables. Elle est faite pour protéger les beaux. Les puissants. Les rentables. Tout le monde a entendu quelque chose. Tout le monde connaît quelqu’un. On murmure les rumeurs lors des dîners de marque. On hoche la tête avec connivence dans les clubs. On lâche des noms dans nos groupes de discussion. Mais dans cette industrie, savoir n’est pas du pouvoir, c’est du poison. Ça vous ronge la bouche et rend les douceurs amères. Et pourtant, les gens restent silencieux. Parce que le silence coûte moins cher que la vérité. Et que la fête passe toujours en premier.
Par Louis Pisano