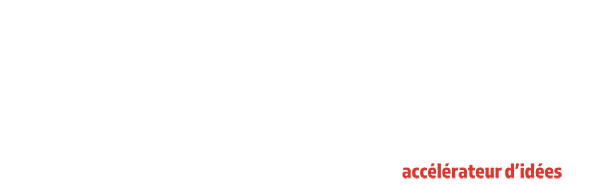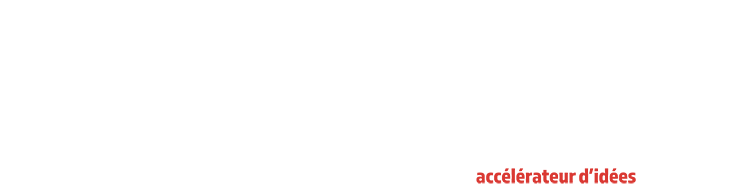Portée par l’économiste Gabriel Zucman, la « taxe Zucman » proposait d’instaurer un impôt plancher sur le patrimoine des nabab français. Manque de pot pour les élans égalitaires de nos concitoyens, le Sénat l’a rejetée. L’économiste le plus solidaire de France refait les comptes.
Légende photo : OO-DE-LALLY_ Le Robin des bois de l’économie, Gabriel Zucman, proposait de taxer à hauteur de 2% le patrimoine des plus riches (0,01% des contribuables). Guess what ? L’idée, soutenue par sept prix Nobel d’économie, n’a pas plue aux mandarins du Sénat.
Après des années de recherche, Gabriel Zucman arrive à une conclusion terrifiante : la France, pays le plus taxé au monde, est un paradis fiscal pour les riches. Nous assistons ces dernières années à un double mouvement. D’un côté, une augmentation très forte de la concentration des richesses entre les mains d’une petite partie de la population et de l’autre côté une pression fiscale de moins en moins forte sur ces ultra-riches. L’exemple le plus criant est l’augmentation des 500 plus grandes fortunes françaises qui, selon le journal Challenges, serait passée de 200 milliards d’euros en 2010 à plus de 1200 milliards en 2024, soit une multiplication par six. Personne dans la classe pauvre, moyenne et supérieure n’a constaté une telle hausse de son patrimoine. Pour rééquilibrer cette injustice, Gabriel Zucman propose une taxe plancher à 2 % du patrimoine des ménages dont la fortune dépasse les 100 millions d’euros (1800 foyers fiscaux). Cette taxe pourrait rapporter de 15 à 25 milliards pour le budget de l’État. Une manne intéressante à l’heure où le gouvernement cherche 40 milliards majoritairement sur les retraités et l’assurance maladie, autant dire sur les vieux et les malades. Mais un certain nombre d’arguments s’élève pour critiquer cette taxe, voici les deux principaux.
CARACTÈRE EXCEPTIONNEL
Les centi-millionnaires et les milliardaires seraient des entrepreneurs exceptionnels qui seraient rémunérés grâce à leur création de richesses. La réalité est un peu différente, selon le Financial Times, 80 % des milliardaires seraient des héritiers. Et pourtant, chaque biographie ou portrait de ces patrons milliardaires propose le même conte de fées : l’ascension fulgurante d’une personnalité hors du commun. Des signes précoces repérés dès l’enfance et attestant d’un caractère exceptionnel à la bande de copains d’école prestigieuse témoignant des qualités de leader du futur milliardaire… Telle est, dans la majorité des cas, la présentation à l’eau de rose du parcours de ces grands patrons qui ne dépasse guère le cadre des qualités intrinsèques. Le succès serait donc à aller chercher dans les caractéristiques de l’individu – notamment le fameux esprit d’entreprise – plus que dans les conditions qui lui ont permis d’y parvenir – l’héritage ou le cadre économique (baisse d’impôts, spéculation) qui a permis à cet héritage de s’auto-valoriser. Ce genre de storytelling, isolant les fortunes accumulées de leur environnement, est un pilier important de la légitimation de politiques fiscales accommodantes avec les très riches, ou même d’une forme de laxisme voire de compréhension à l’égard de l’évasion fiscale.
FUITE DES RICHES
C’était le même argument qui était employé pour justifier la suppression de l’impôt sur la fortune (ISF), un impôt concernant 358 000 foyers fiscaux détenant plus d’1,2 million d’euros de patrimoine. Les défenseurs de sa suppression avançaient la fuite des riches. Or, sur cet argument, les chiffres de l’administration fiscale montrent que les départs sont de l’ordre de 800 par an et les retours de 300 soit un solde de départs nets de 500 ménages (0,2 des assujettis à l’ISF) pour un manque à gagner moyen s’élevant à 170 millions d’euros par an pour les finances publiques. C’est donc pour éviter de perdre 170 millions d’euros par an que le gouvernement a décidé d’exonérer une partie de l’ISF et de perdre 3,5 milliards d’euros par an ! La fuite des riches est souvent surestimée, c’est une manière de bloquer toute possibilité d’augmenter les taxes.
Pour bien comprendre la nécessité de mettre en place une taxe sur les super-riches, il faut bien intégrer que cette taxe ne les rendra pas plus pauvres. Elle permettra juste de corriger un phénomène qui s’accélère depuis les années 1980 : le fait que les riches s’enrichissent plus vite que le reste de la population. Ce n’était pas le cas entre 1950 et 1970, cela signifie donc que le fonctionnement de l’économie a été mis à leur service ces quarante dernières années.
Par Thomas Porcher