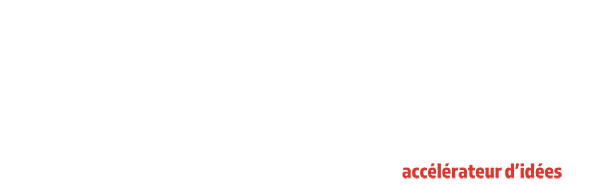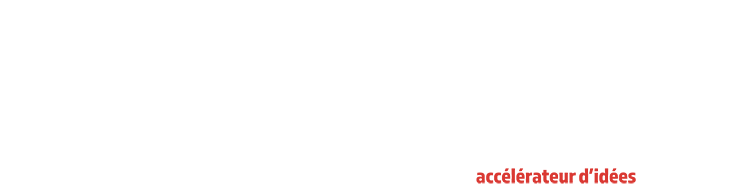Il y a seize ans, sa carrière de rockeur prometteur se terminait en garde-à-vue. Pas épargné par le sort, Gustave Rudman a trouvé la rédemption grâce à la musique classique, à la foi et à des collaborations inattendues. Portrait d’un artiste inclassable qui doit autant à Jean-François Bizot qu’à Jean-Sébastien Bach.
Décembre 2006 : on interviewe les Naast dans les bureaux de leur label, Source Etc. Ils ne sont pas tous majeurs mais tous très lookés, avec dans leur discours une forme de superbe où leurs ennemis voient de l’arrogance. Le leader, Gustave, ne manque pas de charisme, ayant hérité de l’allure de sa mère, ancienne mannequin – ce qui lui fait un point commun avec Julian Casablancas. Les Naast sont en plein buzz, s’apprêtent à sortir leur premier album, Antichambre, vont assurément tout casser. À l’arrivée ? La jeune scène rock parisienne fait pschitt, les Naast se sabordent (nous verrons comment) et seuls les BB Brunes tirent leur épingle du jeu en connaissant un relatif succès populaire.
Les années ont passé. De temps en temps, on entendait parler en bien de Gustave par des gens de talent (le producteur Adrien Durand, l’écrivain Boris Bergmann). Gustave s’était mis à la musique classique, il était devenu producteur, il avait bossé pour The Weeknd, Mika ou Sia, il avait changé de patronyme, on le croisait à Londres, puis à nouveau à Paris, on retrouvait sa trace à Los Angeles… Dernièrement, il est réapparu dans la mode : lors de l’une des dernières collections Balenciaga, Naomi Campbell, Kim Kardashian, Bella Hadid et d’autres défilaient sur sa musique. « C’était un peu surréaliste, un concentré de pop-culture », sourit Gustave à la rédaction où il est passé nous voir en juin. Depuis 2006, il a pris quelques kilos. Il a surtout emmagasiné une expérience qui mérite d’être racontée.
OPTION THÉÂTRE
Gustave naît en août 1988 d’une mère suédoise et d’un père anglais, Paul Rambali, qui a du sang indien et italien. Journaliste après avoir été disquaire grâce à Marc Zermati, Rambali a bossé au NME dans les années 1970, puis à The Face dans les années 1980. À l’arrivée de Gustave il quitte l’Angleterre pour s’installer en France, d’abord à Paris, puis rapidement à Joinville-le-Pont, non loin de la propriété de son ami Jean-François Bizot à Saint-Maur-des-Fossés. Petit, Gustave fréquente donc la bande d’Actuel : « Tous les mercredis et les samedis on allait là-bas, où il y avait les amis de mon père. J’ai rencontré très tôt plein de gens intéressants – un vrai privilège. Je me souviens de Bernard Zekri, Léon Mercadet, Patrice Van Eersel… Bizot avait une aura, un côté messianique, c’était une figure fédératrice. Mon père disait que c’était un génie, mais sa maison était dans un bordel invraisemblable. C’était mon argument ultime quand mon père me reprochait de ne pas ranger ma chambre : je lui disais que je faisais comme Jean-François ! »

Gustave est un garçon atypique. L’ancien fils spirituel de Jean-François Bizot travaille ces jours-ci sur un opéra conceptuel. Avec lui, il faut s’attendre à tout.
Bizot fait écouter le Velvet Underground à Gustave, élevé par ses parents au son de la soul et du reggae, et au visionnage répété de Yellow Submarine et de Fantasia : « Ça a nourri ma psyché : le rock et la musique classique associés à l’image ». Ayant appris le piano « sans être un enfant prodige », Gustave arrive vite à l’adolescence et télécharge du rock à la papa type Stooges, façon de faire une psychanalyse : « J’avais une relation compliquée avec mon père, et le rock était une manière inconsciente de recréer du lien, et de me sentir exister. En 2004, mon père m’a emmené à la Brixton Academy de Londres voir un concert des White Stripes. On se parlait peu, et ça a pris une signification énorme. J’ai été électrocuté par la simplicité, juste deux musiciens sur scène. Dans le public, des gens jeunes et bien habillés. Il y avait de la vie là-dedans… »
Le retour à Joinville-le-Pont est difficile. Au lycée d’Arsonval de Saint-Maur, Gustave traverse un « désert psychologique », ne se reconnaissant pas parmi les gandins de sa génération, « restant attaché à ce rêve des White Stripes à la Brixton Academy ». Par l’entremise de son père, il écrit quelques articles dans Rock & Folk, ce qui lui permet « d’aller à des concerts gratuitement et d’apprendre à synthétiser des idées ». Précisons qu’il fait option théâtre. Background culturel et présence scénique, il a toutes les cartes en main pour monter et mener un groupe, ce qu’il fait en s’associant avec son voisin Nicolas, batteur de son état.
PAPIERS ÉLOGIEUX
Nous sommes au milieu des années 2000 : initié par les Strokes à New York en 2001, le retour du rock peine à s’infiltrer dans une France gouvernée à la fois par la Star Academy (côté Universal/TF1) et par la variété chic à la Carla Bruni (côté Naïve/France Inter). « Très peu de groupes véhiculaient alors cette énergie rock dans Paris », exception faite des excellents Parisians. Les Naast assurent un soir leur première partie au Cruiscin Lan, un pub irlandais vers Châtelet. C’est l’étincelle.
Très vite, un lieu, le Bar III (rue de l’Ancienne-Comédie), s’impose comme incontournable : « C’était Raw Power ! Une expérience cathartique, de la pure libération électrique. » Rappliquent les Brats et les Plastiscines, puis les Shades et Boris Bergmann : « Nous étions principalement des banlieusards, sauf les Second Sex qui venaient de l’École Alsacienne, du 6e arrondissement. On a eu ensuite une image de bourges, ce que nous n’étions pas. C’était un peu lourdingue, et injuste – Jeff, qui jouait dans les Naast, venait d’une cité. » Branco de Phoenix parraine cette scène, servant de « mentor » à Gustave, tout comme la romancière Georgina Tacou et Yarol Poupaud, « très généreux, toujours prêt à aider ». La bande fait la fête chez Patrick Eudeline à Pigalle, et a droit à des papiers élogieux dans Rock & Folk. Puis le Gibus récupère le mouvement en organisant des soirées, où se greffent au passage les BB Brunes, qui abandonnent leur son massif à la Blink-182 pour surfer sur la vague garage-rock : « Le Gibus nous a institutionnalisés, les maisons de disques sont arrivées… Ce n’était que le début de notre scène mais déjà pour moi la fin de quelque chose. J’ai découvert l’exposition médiatique, et je n’ai pas aimé ça, je l’ai très mal vécu, retrouvant la solitude que je vivais au lycée. On nous traitait de bébés rockeurs avec mépris, façon de minimiser une génération qui avait quelque chose de lumineux. Il y a eu là une perte d’innocence. »
« J’ÉTAIS VENU POUR FAIRE DE LA MUSIQUE ET JE ME RETROUVAIS DANS UNE CELLULE. JE N’AVAIS QUE 18 ANS… »
Les Naast sortent Antichambre et partent en tournée. Hélas, la province les attend avec une hostilité féroce : il est question de faire la peau aux minets parigots. Le 24 mars 2007, un concert dégénère à Bègles. Dans une grosse bagarre, Gustave est contraint de prendre une fourchette pour se défendre et atteint malencontreusement à l’œil le bassiste du groupe Cowboys in Africa : « Je l’ai blessé par accident, et par la suite il n’a eu aucune séquelle. Mais quand même… J’y ai pensé toute cette nuit-là, en garde-à-vue puis au dépôt, allongé à regarder le plafond. J’étais venu pour faire de la musique et je me retrouvais dans une cellule. Je n’avais que 18 ans. Je me suis dit que ce chapitre était fini ».
REPRISE DES ÉTUDES
En pleine descente dostoïevskienne genre Raskolnikov du rock, Gaspard écoute Ravel, Lalo Schifrin, Burt Bacharach : « Ça m’a rebranché à Fantasia, j’ai compris que c’était ça mon langage ». Ayant découvert le prog-rock grâce à Adrien Durand, il écrit un deuxième album « hyper cryptique », enregistre des démos mais arrête les Naast. Il renonce aussi au nom de son père (Rambali), pour faire inscrire sur son passeport celui de sa mère (Rudman) : « Je voulais avoir une page blanche, être anonyme, voir si j’avais de la musique en moi ou si je n’étais qu’un imposteur. J’ai eu la chance de ne pas être dans la drogue à cette époque-là : j’aurais vraiment pu me suicider. Je n’avais quasiment pas de ressources. J’ai fait une musique de dessin animé qui m’a permis de payer mon avocat et de vivoter. Je me sentais coupable. C’était très lourd à assumer... »
Heureusement, il rencontre l’amour (une histoire qui durera dix ans) et, se sentant apaisé, il reprend des études, d’abord à la Schola Cantorum puis au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, à la Villette : « J’ai travaillé dur, jour et nuit. C’était une question de vie ou de mort. À la Schola Cantorum, mon prof Pierre Doury, ancien organiste de Saint-Sulpice, me voyait comme un chien fou à dresser. J’ai appris le contrepoint et écouté Bach. Il faut savoir que j’ai été baptisé protestant. Par Bach, j’ai renoué avec la foi. Il y a dans sa musique une profondeur qui aide à accepter son destin. J’ai décidé de ne plus me poser de questions, d’avoir un rapport mystique à la vie. Je me voyais comme un criminel, et Bach m’a fait comprendre qu’il y a autre chose au-dessus de nous. »
En 2011, miracle : le producteur d’Antichambre, Julien Delfaud, présente Gustave à Woodkid, qui cherche quelqu’un pour faire des arrangements sur le titre « Iron ». Gaspard saute sur l’occasion : « C’était génial : une façon d’expérimenter ce que j’apprenais dans mes études, d’enregistrer des cuivres, etc. Je suis parti d’accords que j’avais travaillés en cours de contrepoint, des trucs qu’on peut jouer à l’orgue. Ce morceau m’a sauvé. J’avais existé comme artiste par l’image, et cela me prouvait que je pouvais exister comme artisan. Ça m’a redonné confiance ».
Chez Sony, Guy Moot se dit que Gustave pourrait mêler pour d’autres pop et classique. Il le fait venir à Londres et l’introduit à Labrinth : « Je n’étais pas fan au début, mais j’ai vu chez lui plein de vieux synthés, un vocoder ayant appartenu à Herbie Hancock. Labrinth aussi a été blessé par l’industrie musicale. Ça a été et ça reste une grande rencontre amicale et artistique : il m’apprend la production, l’électronique, et je lui apporte des principes de composition, d’orchestration et d’harmonique. »
Après quelques années dans l’ombre (bossant pour Mika ou Sia), il décide de ne pas resigner avec Sony, las d’être « l’esclave des stars ». Une fois de plus, son ange gardien vole à son secours : « J’étais à nouveau dans un no man’s land psychologique, j’étais perdu, fauché, ma copine m’avait quitté, j’avais des moments de déréalisation… Je me suis retrouvé à un dîner à Los Angeles avec le manager de Labrinth, qui est aussi celui de Miley Cyrus. Je me demandais ce que je foutais là, même si j’essaie désormais de profiter des incongruités de la vie. Labrinth m’a présenté à Sam Levinson. Un peu nerveux sur sa vapoteuse, ce dernier m’a montré un épisode d’Euphoria. J’ai dit que j’imaginais une musique comme celle de Répétition d’orchestre de Fellini, un truc à la Nino Rota. Quelques mois plus tard, HBO m’a contacté. »
Comme toujours dans les moments décisifs de sa vie, Gustave coupe tout et file en Suède, dans le Värmland, où la famille de sa mère possède une petite maison au bord d’un lac, coupée du monde. Requinqué, il compose deux morceaux de la BO d’Euphoria, et enchaîne avec celle de Tranchées de Loup Bureau.
VIRAGE CLASSIQUE
Nouveau rebondissement dans une trajectoire qui n’en manque pas : à la Mostra de Venise où Tranchées est présenté, sa musique est repérée par Clémande Burgevin, qui en parle à des amis qu’elle a chez Alaïa. Et voici Gustave propulsé compositeur pour Alaïa, Gucci et Balenciaga : « L’industrie de la musique est franchement dégueulasse, elle broie les gens de talent. Le monde de la mode, contre toute attente, est beaucoup plus humain. C’est très créatif. On peut s’y exprimer librement, avec des moyens et de la considération ». La mode l’a-t-elle sauvé à son tour ? « Ne mets pas ça comme titre d’article, attention ! Dis plutôt que j’ai sauvé la mode ! Bon, je déconne… »
Le virage classique de Gustave peut faire penser à celui, plus récent, de Thomas Bangalter. Que pense-t-il de lui ? « Je l’ai rencontré juste avant qu’il sorte son disque, par Melvil Poupaud, et on a parlé de tout ça. J’ai été très touché par sa musique, et par le fait qu’il arrête un duo aussi installé et iconique que Daft Punk pour aller vers ce qu’il aime. Dans l’hindouisme, qui m’intéresse à causes des racines indiennes de mon père, il y a cette idée que la destruction fait partie de la création. Je l’ai déjà fait, et je le referai. »
S’il ne compte pas arrêter la mode, qui lui permet de créer « des compositions à part entière », Gustave est déjà dans une autre énergie : « J’ai rencontré Vanessa Beecroft à Los Angeles l’été dernier. Elle a faite toute l’identité visuelle de Kanye West depuis 2008. C’est une artiste de génie, je ne connais personne d’aussi brillant. Elle m’a demandé de faire la musique pour une performance produite par Kanye West qu’elle a montée à la Cinecittà de Rome avec trois cents femmes. Ses œuvres sont des tableaux vivants absolument fascinants. Elle est plus âgée que moi, elle a 54 ans, elle m’emmène ailleurs. On a des projets ensemble, dont un opéra. Ça m’excite beaucoup, ce sera pour l’année prochaine… »
Carrière peu banale, décidément, que celle de Gustave Rudman. Qui en convient en riant : « Au début, j’en avais honte. À 34 ans, bientôt 35 ans, j’aime ce voyage, cette aventure mystique qu’est la vie. Je suis émerveillé de ce que la musique m’offre comme expériences. Je me souviens que, plus jeune, je voulais avoir un des parcours les plus bizarres de l’histoire de la musique. Eh bien, c’est en train de m’arriver ! »
Single « Two Shadows » (Forever Changes).
Par Louis-Henri de La Rochefoucauld
Photos Vanessa Beecroft