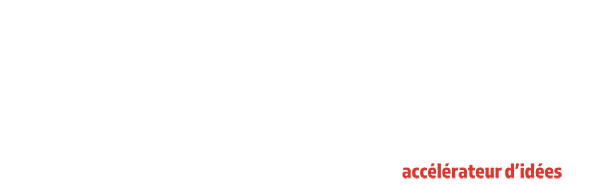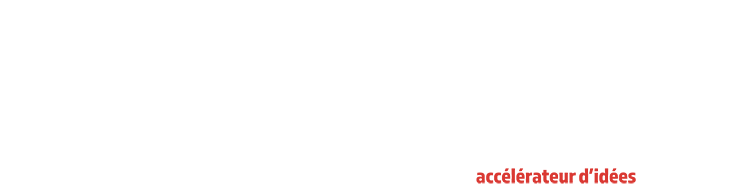Longtemps réservé aux professionnels des industries culturelles, le feedback vient à présent de chaque consommateur. Résultat, une partie de la création suit à la lettre leurs envies. Décryptage.
Légende photo : RETOUR SUR EXPÉRIENCE_ Malin ! Le sixième album studio de la chanteuse américaine Kesha, Pediod, a été modifié dans sa quasi-intégralité en fonction des réactions de sa fanbase – elle avait sorti trois singles-test avant de faire paraître la tracklist finale.
« Il ne faut pas demander au public ce qu’il veut, il ne le sait pas. » Lorsque Georges Lucas déclame cette phrase comme un mantra au Festival de Cannes 2024, elle sonnait déjà comme un dicton de l’ancien monde.
Créer par le bas, en fonction des retours du public récoltés à grands coups de projections tests : fut un temps, c’était le fonctionnement de la culture de masse. Pensez aux séries télévisées, dont les histoires d’amour et de trahisons étaient scénarisées en express selon les obsessions récentes des téléspectateurs. Seulement voilà, en miroir de ces productions aux grandes ambitions commerciales, se construisait le cinéma d’auteur, l’art de niche et autres secteurs dont la rentabilité importait moins. Les consommateurs de cette culture étaient moins nombreux, plus élitistes peut-être, en tout cas plus difficiles. Pour Karim Ech Choayby, directeur artistique dans l’industrie musicale, cette séparation n’existe plus. « Dans les années 1990, on raisonnait pour le public d’un certain genre ou artiste. Aujourd’hui, l’auditeur est plus volatile, il écoute de tout. Et surtout, il ne se définit ni par artiste ou genre de prédilection, mais individuellement, titre par titre. »
PLAYLIST PAR MOOD
Selon lui, la première grande différence est celle des distributeurs. « Avant, pour que le public ait accès à ta musique, elle devait passer à la radio. Les programmateurs devaient entendre ton son, le sélectionner, et décider de le passer à l’antenne. C’est après que venaient les retours des auditeurs, qui décidaient du temps qu’il allait rester. » Similairement, les films devaient être programmés en cinéma, les livres passer dans les mains des éditeurs, et les pièces être financées par un théâtre. « Il y avait déjà des “recettes” bien sûr. On disait par exemple qu’un jeune artiste ne devait jamais commencer par une balade : mais il fallait un titre uptempo pour passer en radio plus rapidement. »
Aujourd’hui, les grandes plateformes qui permettent d’atteindre directement le public ont été créées par des entrepreneurs, qui ont privilégié la quantité à la qualité. Le but étant d’avoir le plus gros catalogue, pas d’offrir une sélection triée sur le volet. « Avec Spotify ou Deezer, les auditeurs consomment des playlist par “mood”. En tant que créateurs, il faut que notre son s’inscrive parfaitement dans cette playlist, tout étant suffisamment disruptifs pour donner envie de l’ajouter à ses likes personnels. »
CIBLAGE ULTRA PRÉCIS
Ces nouveaux modes de diffusions, ainsi que les réseaux sociaux ont produit la mine d’or du feedback : des tonnes et des tonnes de données. Celles-ci sont plus ou moins accessibles, mais permettent de cerner très précisément ce qui plaît à tel ou tel profil. Pour un directeur artistique comme Karim, « elles permettent d’établir des cahiers de tendances. De définir le cadre de ce qui marche dans le moment. Mais le métier n’est fait que de contre exemples. Personne n’avait vu venir Theodora et son “Kongolese sous BBL” (le titre de bouyon qui a fait percer la jeune chanteuse, ndlr). Pourtant on avait tous repéré qu’il se passait quelque chose dans le bouyon. » De là découle une sorte d’homogénéité dans les sorties, même qualifiées de niche. Ainsi, on voit depuis quelques années fleurir les films dits « Eat the Rich », satires sociales mettant souvent en scène une vengeance – venue des pauvres, du destin, de l’écologie – sur des riches. Parmi eux, les très bons Parasite et Sans Filtre, le passable Le Menu et le très mauvais Blink Twice. Sur une temporalité plus resserrée, on observe le même phénomène avec cette rentrée littéraire croulant sous les romans « ôde à ma mère ».
Le problème, s’il en est un, c’est que tout un chacun peut avoir accès à ces données. D’ailleurs dans ce climat, dès qu’une œuvre marche un peu mieux, les rumeurs l’accusent d’avoir été générée par IA. Ce fut le cas lorsque le rappeur Jul a sorti abruptement son titre de variété « Toi et Moi ». Pour casser ce côté culture ChatGPT, l’industrie insère donc dans ses créations des séquences de fausse subversion. Avec par exemple ce qu’on nomme le phénomène de Saltburnification : l’insertion dans un film de scènes chocs – souvent violentes ou érotiques –, compréhensibles indépendamment du scénario et qui n’y ajoutent d’ailleurs rien. Efficaces quand elles sont isolées sur les réseaux, elles donnent à l’œuvre dont elles sont extraites une aura sulfureuse. Une aura seulement, puisque si elle tombe plus souvent juste, lorsqu’elle décide d’adopter les stratégies de la culture de masse, l’industrie de niche perd sa capacité de surprise et de subversion.
Par Adèle Thiéry