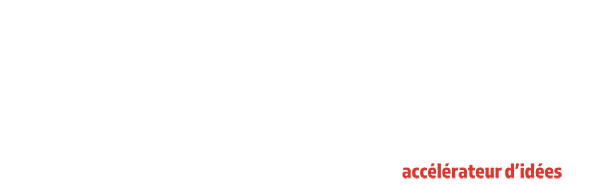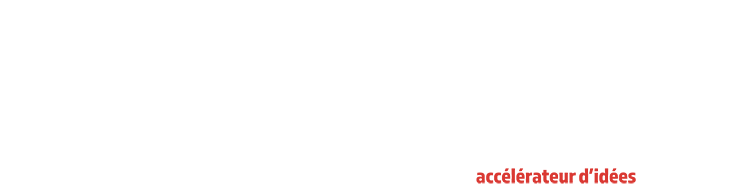TRIBUNE – On a pu lire qu’Alain Passard aurait sombré avec son virage tout végétal. L’Arpège, fréquenté depuis quinze ans, et il y a dix jours encore, avec au menu les mêmes plats que ceux dégustés par Stéphane Durand-Souffland, n’avait pourtant rien du naufrage décrit. Les critiques de ce dernier, d’ordinaire si justes, portées par une plume littéraire et un palais d’une rare précision, manquent cette fois l’essentiel : très loin de cette perception réductrice, se révèle l’aboutissement d’une œuvre de toute une vie, en parfaite résonance non avec une mode passagère, mais avec le long mouvement de l’histoire de la cuisine française.
On a voulu faire croire qu’à l’Arpège, il ne restait que des assiettes désordonnées, un chef épuisé et un menu sans frisson, sans émotion. Pourtant, on y a vu un homme fidèle à son idée, qui pousse plus loin que jamais sa logique de faire du légume la matière première de sa palette culinaire. Oui, la côte de bœuf et le bar aux olives de Kalamata ont disparu. Oui, il n’y a pas le plat signature qui hante encore la mémoire une fois rentré chez soi. Mais ce manque nous semble volontaire. Ce que Passard propose désormais, c’est une autre mémoire : celle d’un navet, d’une tomate, d’un consommé clair, d’un velouté ou d’un jus. Une mémoire subtile, dépouillée, sans gras refuge, mais infiniment plus exigeante.

À peine arrivé, on comprend l’esprit de la maison : les mignardises sont de jeunes pousses de légumes. Mais là où ailleurs on pourrait se sentir pris pour des naïfs qu’on amuse avec un radis trempé dans le sel, ici le geste est d’une autre nature. Jeunes carottes effilées, betteraves miniatures, pousses de pois, bourgeons de chou ou fleurs de courgette sont présentés comme des promesses, dans leur état le plus pur. La décoration des tables, composée des mêmes fleurs et plantes du potager, prolonge cette cohérence. On ne sert pas un gadget rustique, mais l’annonce claire d’une cuisine qui élève le végétal au rang de matière noble, sans condescendance ni facilité.
Par la suite, son menu n’est pas une succession de plats hasardeuse. Là où certains y voient des répétitions, on a voulu y voir un travail d’orfèvre sur la variation. Le carpaccio tomate-poire ouvre sur la rencontre du légume et du fruit, entre fraîcheur et sucrosité. La tarte de légumes au vinaigre de sureau prolonge ce dialogue, en mariant le végétal à une touche florale et acide qui en intensifie les reliefs. Vient ensuite la trilogie de ravioles potagères, nouvelle incarnation d’un plat historique de la maison, qui rassemble les forces des deux séquences précédentes – le fruit, le légume, l’acidité, la floralité, la fraîcheur – pour les élever en un tout cohérent. Cette simplicité apparente cache une prouesse : la pâte des ravioles, façonnée sans œuf ni beurre, reste exceptionnellement translucide et fidèle au goût attendu des connaisseurs. Elle témoigne sur le moment d’un travail de précision en cuisine, mais exprime aussi la fidélité à l’histoire de la maison et le mouvement d’évolution constante qui définit la signature de l’Arpège.
On a raillé sa salade pralinée, prétendument un gag. Il faut y voir un haïku : une feuille encore vibrante de jardin, froissée de pluie, nervurée d’amandes, nappée d’une huile de géranium qui en prolonge la fraîcheur. D’autres trois-étoiles ont d’ailleurs érigé l’ingrédient unique en signature : au Noma, René Redzepi servait une betterave entière cuite en croûte de sel ; à Azurmendi, Eneko Atxa propose un œuf à peine assaisonné, simplement cuit à basse température ; et chez Kyubey, à Tokyo, un sushi de thon gras nu sur le bois suffit à atteindre la perfection
On a balayé d’un revers sa transparence de tomate, jugée insignifiante. Elle m’a rappelé, comme une madeleine de Proust, une enfance au potager de mes grands-parents, lorsque jeune enfant, je ne savais pas encore apprécier la tomate cueillie à maturité, jamais glacée par le réfrigérateur, posée dans l’assiette comme un trésor fragile, mais au goût inimitable et surtout introuvable, même chez les primeurs de luxe, qu’on ne peut redécouvrir que dans les potagers familiaux d’été ou à cette table de la rue de Varenne. C’est cela, le geste de Passard : faire d’un produit simple une expérience. Pour cela, il choisit le murmure plutôt que le spectaculaire.
On dit qu’il est plus facile de travailler le végétal que la chaire animale. C’est une erreur. Là où la viande et le poisson apportent d’eux-mêmes profondeur et complexité, avec autorité, et où l’œuf, lui, offre d’emblée une matière nourrissante et malléable, riche de ses propres sucs, le légume impose d’autres règles plus exigeantes. On ne peut pas pousser la cuisson sans le condamner au brûlé, ni compter sur le gras pour donner rondeur et longueur. Il faut donc inventer l’intensité légumière autrement. Passard relève ce défi avec les jus, les associations acides ou florales, la vapeur douce, les bouillons clairs, les émulsions millimétrées, le cru chaud, les fermentations lentes, les infusions… Ses sauces en sont la preuve : puissantes, concentrées, elles ne doivent rien à l’effet Maillard, mais tout à la réduction extrême de matières végétales. Des volumes entiers de légumes cultivés, récoltés, épluchés ou laissés intacts, assaisonnés puis cuits, se transforment pour ne livrer que quelques cuillerées d’une densité exceptionnelle.
Autre métamorphose : celle du sommelier. Ici, le vin n’accompagne plus la chair, il dialogue avec la sève. Les grands rouges tanniques, jadis indissociables des viandes, ont disparu. Leur majesté cède aux subtilités de blancs ciselés, parfois effervescents, dont la finesse s’accorde au rythme du potager. Autour, le service sans gant blanc prolonge cette révolution. Le vouvoiement demeure, mais porté par des équipes jeunes déjà sûres de leurs gestes, qui tiennent leur savoir-faire avec une simplicité désarmante. Ici, on ne récite pas une carte : on raconte chaque soir l’histoire du jour, ce que le jardin a livré le matin même. Et sous cette fluidité affleure un labeur invisible que seule l’oreille attentive décèle : traduire en plusieurs langues une cuisine faussement simple où il leur faut apprivoiser le vocabulaire français du potager dans ses moindres nuances. Pâtisson, topinambour, cardon, rutabaga, et bien d’autres encore, autant de noms effacés du quotidien, qui revivent ici.
Ce végétalisme radical ne saurait être réduit à un effet de mode. Il s’inscrit dans la grande tradition de la cuisine française, où chaque génération de chefs a cherché à affiner la technique pour gagner en précision des cuissons, en netteté des goûts et en lisibilité des assiettes. Si Carême et Escoffier, fondateurs de la grande tradition culinaire française, avaient codifié l’abondance, défini l’architecture des sauces mères, ordonné les fonds et affirmé la puissance du rôtissage, de la réduction et du glaçage, la « Nouvelle Cuisine » du XXe siècle s’attacha à alléger cet héritage. Les Troisgros ont travaillé l’acidité et apporté la cuisson minute. Guérard formalisa la cuisine minceur avec la vapeur douce et la réduction des matières grasses dans ses plats. Chapel prêcha le peu d’ingrédients au service d’un goût net. Robuchon imposa la juste cuisson, et jamais plus de trois saveurs. Dans ce mouvement, Michel Bras changea le statut des végétaux, son gargouillou faisant entrer le jardin dans la haute cuisine, non comme garniture mais comme sujet. Loiseau, lui, condensa ces lignes pour faire de l’épure un système, donnant ses lettres de noblesse à la réduction comme vérité du produit, et à la sauce transparente comme preuve technique.
C’est dans ce prolongement que s’inscrit Passard : héritier du rôtisseur qu’il fut, mais visionnaire du potager qu’il a fait sien, il porte à son terme la poussée du végétal en le hissant au rang d’univers exclusif de la haute cuisine. Dès 2001, après la crise de la vache folle, il avait d’ailleurs choisi d’écarter la viande de sa carte, avant de ne la réintroduire quelques années plus tard, qu’avec une extrême parcimonie. Il crée ses propres potagers pour maîtriser sa matière, et assume une cuisine de jardin où le fond n’est plus un jus de carcasse mais une extraction végétale, et où la puissance ne vient plus de la gélatine mais du temps, de l’évaporation, de la fermentation, de la macération, ou des bouillons devenus concentrés. Le tout végétal ne semble pas être un caprice ni une mode, mais l’étape suivante d’une même logique.
Et si l’on devait imaginer la suite, elle semblerait déjà tracée. Peut-être qu’un jour Alain Passard fermera l’Arpège à Paris pour ne vivre qu’au milieu de ses jardins, rappelant que trois étoiles signifient « vaut le voyage », et qu’il faudra alors aller jusqu’à lui, sur ses terres, pour goûter une cuisine née de la graine et menée jusqu’à l’assiette sans autre étape, sans transport, sans refroidissement, sans rupture entre le sol et la table. Peut-être renouera-t-il avec la mer, comme un écho à sa Bretagne natale, en inventant un nouveau « terre et mer » : non plus avec la sole et le foie gras ou avec le homard et la volaille, mais avec les algues de l’Atlantique mariées aux champignons du Bois Giroult en Normandie, ou aux légumes des serres du Gros Chesnay, dans la Sarthe. En attendant, ce que l’on constate aujourd’hui, c’est un homme présent dans sa cuisine jusque tard dans la nuit, chose devenue exceptionnelle chez les chefs triplement étoilés éparpillés entre leurs établissements aux quatre coins du monde. Passard, lui, demeure fidèle à son jardin, à ses saisons, à ses équipes et à sa maison, cinq jours sur sept, tout au long de l’année.
L’une des plus grandes émotions culinaires fut vécue au Pays basque espagnol, chez Akelare : une boîte de caviar présentée à table ne contenait pas les grains noirs attendus, mais de jeunes petits pois, à croquer simplement au gros sel. Ce geste, d’une simplicité étonnante, suffisait à provoquer l’émotion des trois étoiles. Le Michelin ne se trompe pas : il ne couronne pas toujours l’accumulation ou le spectaculaire, mais aussi cette capacité rare à émouvoir avec presque rien. Car quoi de plus grand que la simplicité de la nature, si difficile à reproduire dans une assiette ? Faire simple est la chose la plus ardue : en peinture, Picasso laissait ses visages inachevés pour atteindre l’essentiel, et en couture, Dior savait que la robe la plus épurée exigeait le plus de minutie. En cuisine, Alain Passard montre sûrement que le même effort est nécessaire : il faut des heures de soin et des années de travail de précision et de technique pour qu’un navet, une tomate ou un petit pois se présentent dans l’assiette avec la force d’une évidence, et bouleversent plus sûrement qu’un faste de viandes et de sauces.
Le 28 septembre 2025
Par Matthieu Creux