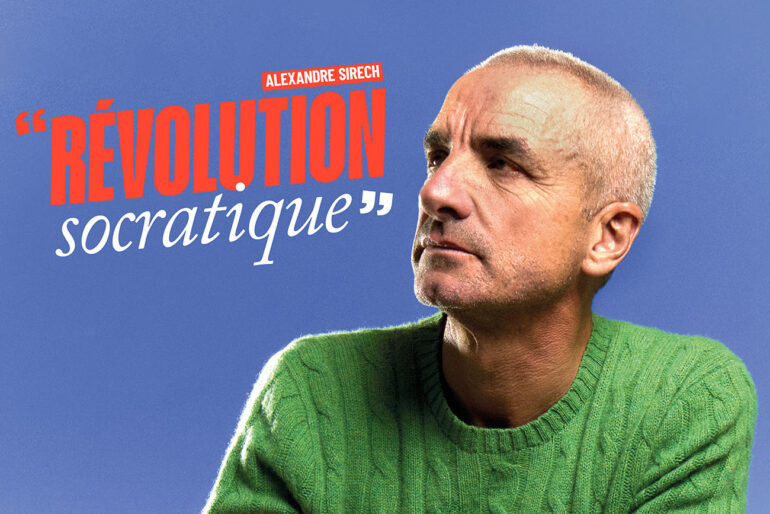À la tête du groupe de spiritueux Les Bienheureux, Alexandre Sirech mise sur l’avenir du whisky français. Éthique du fabriqué en France, opposition aux subventions et syllogismes à la Socrate… Interview mise en point.
Avec votre associé, Jean Moueix, vous avez créé Les Bienheureux en 2014. Esthétique pop, Made in France et éthique stricte, en quoi le marché des spiritueux est-il l’avenir ?
Alexandre Sirech : Cette esthétique très pop était notre première prise de risque. Ensuite, on a appelé notre entreprise Les Bienheureux d’après l’idée que, de l’employé au consommateur, chaque personne doit être heureuse du produit. Pour dépasser le simple claim marketing, on s’oblige à respecter quatre principes.
Lesquels ?
Premièrement, embaucher uniquement en CDI, parce que là où nous sommes situés, à Louchats, en Gironde, sans CDI, un employé n’a pas de liberté. Ensuite, bien payer, avec un minimum d’un SMIC et demi. Par ailleurs, refuser toute forme de subvention, car pour pouvoir honnêtement râler contre notre gouvernement, il faut être droit dans ses bottes. Enfin, ne faire aucune optimisation fiscale, car c’est contre-productif. Maintenant, pour que ce modèle tienne économiquement, nous devons être très agiles, à la manière de David contre Goliath.
Votre stratégie ?
C’est de pressentir des catégories d’avenir et d’en devenir leader. J’ai compris à 22 ans, en commençant dans le whisky écossais en tant qu’ouvrier, que le whisky français serait l’avenir du métier. Rien n’était écossais à part l’eau utilisée. Les céréales venaient de France, d’Allemagne et d’Ukraine. Le matériel, de France et d’Allemagne. Les barriques, d’Espagne. Les bouteilles d’Angleterre. En regardant l’histoire du whisky, je me suis aperçu que c’était un Français qui l’avait inventé, au XIVe siècle, source historique que j’ai trouvée au Vatican. Si la France n’a pas développé ce secteur, c’est pour des raisons historiques et politiques.
Pourquoi 2014 était le momentum pour lancer Bellevoye, votre whisky français ?
D’abord, pour une raison toute personnelle. J’ai un manque de confiance en moi, donc j’ai mis longtemps avant de croire en mes idées. J’ai redressé plusieurs entreprises pour des grands groupes avant d’oser lancer l’entreprise Les Bienheureux, à 40 ans. C’est risqué de lancer une boîte, donc j’ai commencé par de petits changements, ce qui permet, avec beaucoup de travail, de gagner de l’argent.
Pourquoi refuser les subventions ?
Selon moi, c’est le cancer de l’économie française. C’est prendre l’argent des contribuables pour le donner à des entreprises sans qu’ils en soient actionnaires. C’est le contraire du capitalisme. Philosophiquement, c’est irrecevable. Ensuite, ça coûte un pognon monumental à l’État. Enfin, c’est anti-méritocratique et permet à des boîtes mal dirigées de survivre, lesquelles accaparent des parts de marché et freinent la croissance. Ça rend par ailleurs les entrepreneurs schizophrènes. Du lundi au jeudi, ils critiquent l’obésité de l’État et le vendredi, ils remplissent des dossiers de demande de subventions.
Vous qui avez dirigé Havana Club, pourquoi avoir choisi le Costa Rica pour lancer votre nouvelle marque de rhum PURA VIDA ?
Dans la continuité de notre modèle whisky, on a voulu appliquer la même exigence à notre rhum qui passe par la maîtrise de la production. Au-delà de la technique, nous voulions ancrer ce projet dans un pays en accord avec nos valeurs : un lieu où il fait bon vivre, avec des partenaires bienheureux, respectueux de leur terre et de leur culture. Après plusieurs années de recherche, notre choix s’est naturellement porté sur le Costa Rica. Ce pays, riche de grands terroirs de canne à sucre, se distingue par son engagement exemplaire en faveur de l’écologie. Stable, démocratique et libéral, il incarne une vision moderne et responsable du développement, fondée sur la santé, l’éducation et la préservation de l’environnement. Les forêts couvrent plus de la moitié du territoire et un quart du pays est classé en réserve naturelle. Pacifiste – il a aboli son armée dès 1949 – le pays prône la vie pure avec sa devise Pura Vida qui est aussi devenue la façon dont se saluent les costaricains.
Est-ce que le savoir-faire est encore présent en France ?
Il est en train de partir. Sur les bouteilles Bellevoye, il y a une capsule en étain : il n’y a plus de capsulier en France. La tête en bois sur les bouchons, seules deux boîtes en font en Europe. Le verre de nos bouteilles sont faites en France pour le moment, mais je ne sais pas si les verriers vont survivre. La France, pour moi, c’est comme le Japon. C’est la créativité et la qualité qui prime. Je veux être aussi fou que Gustave Eiffel qui livre une Tour alors qu’on lui a demandé une simple antenne.
Dans ce cas, est-ce que votre ambition est de tout faire en interne ?
Ce serait possible, si nous avions le volume de capital risque américain et leur NASDAQ. Si Musk fait tout jusqu’à ses propres boulons, c’est parce que ses entreprises ont pu perdre de l’argent pendant des années. Le CAC40 ne suit pas. Dans Capitalisme contre capitalisme, Michel Albert opposait le capitalisme anglo-saxon, selon lui court-termiste, au capitalisme rhénan, long-termiste. L’histoire lui a malheureusement donné tort. Le marché boursier américain a permis à Jeff Bezos et Musk de perdre des milliards d’euros pendant vingt ans, d’après l’idée qu’ils étaient le futur.
Pensez-vous que ce modèle va continuer ?
Je ne suis pas déterministe. Tout est redressable.
Aujourd’hui, le whisky Bellevoye est servi à l’Élysée. C’est par ailleurs la première marque à être présente en Première et en Business chez Air France. La suite ?
Ce que je cherche à faire, maintenant que Bellevoye s’est imposé, c’est d’aller plus loin. Pour cela, je me suis rendu compte que les grandes idées qui servent à quelque chose, comme les téléphones ou les voitures, sont le produit d’un syllogisme à la Socrate : les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Ainsi SpaceX : il faut une fusée pour envoyer un objet dans l’espace, les fusées coûtent un bras, donc il nous faut des fusées réutilisables. C’est imbattable. Nous présenterons notre révolution l’année prochaine d’après ce syllogisme.
Par Alexis Lacourte
Photo Pierre Cathala