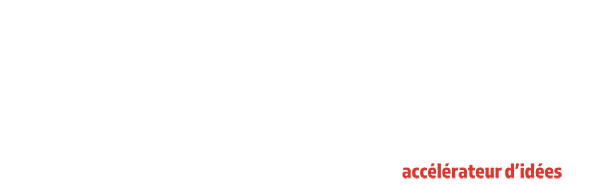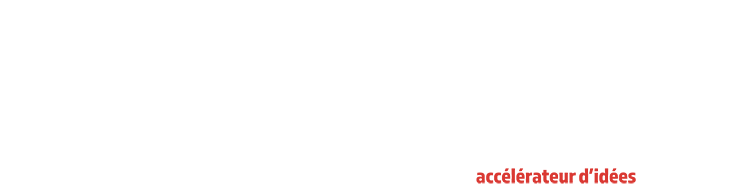n’est Scrolling erratique, connexions compulsives, notifs non-sollicitées… Votre cerveau en surchauffe commence à saturer. Ça tombe bien, la détox numérique est en top tendance : testée et approuvée par notre journaliste ex-techno-junkie. Allô Antonin, tu nous reçois ?
« Félicitations ! La semaine passée, vous avez réduit votre temps d’écran de 14 %, pour une moyenne de 5 h 35 minutes par jour », m’annonce en fanfare mon smartphone. Malaise. Si cette extension cyborg de mon corps voit là l’occasion de sabrer le champagne, de mon côté l’ambiance est à la morosité. 5 h 35. Le chiffre m’apparaît comme un vilain corbeau, porteur d’une nouvelle qui cogne avec la force et l’évidence d’un uppercut : je suis un camé du numérique. De ceux qui se réveillent, mangent et sociabilisent bigo en main. Avant de s’endormir au terme d’un binge scrolling navrant, étalé sur des heures coupables. Mais jusqu’à quels tréfonds le 2.0 me fera-t-il sombrer ?
« PERSONNE N’EST CONDAMNÉ, REGARDEZ-MOI : J’AI SUPPRIMÉ TOUS MES RÉSEAUX… » – AÏNOHA
Selon un sondage Vertigo Research révélé en décembre 2022, 60 % des Français passent le plus clair de leur temps libre face à des « screens ». Télévision, consoles, tablettes & co. Dans une configuration pareille, la surconsommation se drape des funestes atours de la fatalité. « C’est le temps qui veut ça », devise-t-on doctement dans l’entourage. Mais parmi ce concert résigné estimant que, grosso modo, « à l’ère de l’hyperconnexion, comment faire autrement, hein ? », une voix singulière se fait entendre. « Personne n’est condamné, regardez-moi : j’ai supprimé tous mes réseaux », balance Aïnoha. Pur craquage, qui laisserait présager quelque élan de folie survivaliste ? Non, juste un « premier pas » vers le « digital minimalism ». Cette tendance made in USA « en plein boom », promouvant un principe de déconnexion qui pourrait bien « changer notre vie à tous », assure-t-elle. À raison ?
HOLD UP DE L’ONLINE
Si la conversion au mouvement apparaît à notre interlocutrice comme une perspective salutaire à large échelle, c’est que la digital detox sur laquelle elle repose représente un enjeu de santé publique. « Plusieurs études ont déjà démontré les périls en jeu, allant de la perturbation du sommeil aux troubles de l’humeur », pointe Johanna Rozenblum, psychologue. Des symptômes affleurant à partir d’une « surexposition » dont le seuil horaire reste délicat à évaluer, car « l’impact du numérique varie en fonction de chacun ». Mais les mécaniques qui aiguisent le désir de se procurer une énième dose de digital, encore et encore, sont, quant à elles, bien délimitées. « L’industrie numérique maintient notre attention captive grâce à la « captologie », une stratégie qui joue sur nos biais cognitifs », pose Boussad Addad, chercheur en IA et auteur de L’Héroïne digitale : les secrets de l’addiction aux écrans.
Puis d’exemplifier : « Les lancements automatiques de vidéos nous empêchent de décrocher, car le cerveau n’aime pas l’interruption d’une tâche en cours. Quant aux feedbacks des réseaux sociaux, comme les likes ou commentaires, ils sont traités par notre matière grise comme des récompenses déclenchant la sécrétion de dopamine, l’hormone du bonheur ». Raison pour laquelle même le follow de ce pote de pote à tendance lourdaude nous confère une étrange satisfaction. Bon. Mais alors quoi ? Prendre Aïnoha pour modèle, et faire table rase des Instagram, Twitter et autres Facebook ?
« Évitons un manichéisme qui poserait pour principe que les réseaux sont viscéralement nocifs », tempère Marie-Pierre Fourquet, chercheuse en sciences de l’information et autrice de Connectés et heureux. « S’il est vrai que la fréquentation de ces plateformes peut faire germer un Fear Of Missing Out (FOMO) ( une crainte de passer à côté d’expériences enrichissantes si aiguë qu’elle empêche la déconnexion, ndlr) il est aussi avéré que les social medias apportent leur lot de bienfaits. Comme s’informer, tisser des liens, ou valoriser son image ». Mais à condition de faire des réseaux un « usage actif – tchat, partages – et raisonnable ». Sans surprise, en terres numériques comme ailleurs, tout est question de juste mesure. Reste que brider ses e-réflexes n’a rien d’une tâche aisée, dans un paradigme de « surcharge numérique » dont le magnétisme nous tient en otage.
LE JEÛNE NUMÉRIQUE
Comment ne pas se sentir l’esclave du digital lorsque, comme moi, vous êtes incapables de mater un film sans checker 83 fois votre tel’ ? De voir des potes sans lorgner sur vos feeds entre chaque pinte ? « Ces consultations compulsives résultent de l’injonction sociale à réagir immédiatement à la moindre notification », commente l’experte. Et si les sollicitations 2.0 sont sans bornes, nos ressources cognitives pour y répondre, elles, se révèlent limitées. Alors pour éviter le burn-out numérique, il importe d’élaborer une « écologie de l’attention » pensée comme une question « d’hygiène de vie ». Au même titre que les cinq fruits et légumes par jour, disons. Perso, c’est – non sans ironie – sur TikTok, où le hashtag #digitalminimalism pèse 3,1 millions de vues et que le mouvement est érigé en véritable lifestyle, que j’ai découvert les options à portée de clics. Ici on recommande l’usage du « mode avion », là une internaute vante les mérites d’outils limitant le temps d’utilisation d’autres applis. Des options à l’origine dédiées au… contrôle parental. Le signe que pour ne pas céder aux capiteuses sirènes du numérique, nous devrions nous auto-traiter comme des gosses indisciplinés ? Possible.
À moi d’adopter une diététique digital free en usant de procédés coercitifs à destination des pré-ados, donc. Il y a d’abord la honte d’avoir dû en « arriver là », bien sûr. Puis le sentiment grisant d’enfin prendre en main ce à quoi j’étais – lâchons le mot – soumis. Dernier arrêt de l’ascenseur émotionnel : la plénitude. Qui l’eût cru ? Empiler plusieurs jours sans Insta et verrouiller à double tour sa boîte mail après 19 heures, non seulement on y survit, mais ça fait un bien fou. Pour peu, les aliments retrouveraient leur saveur. Alors forcément, il y a comme une envie de passer à l’étape supérieure. En suivant, par exemple, le chemin emprunté par Melchior. Ce pote à la vingtaine triomphante qui, dans un geste farouche – homérique, presque – à lâché son smartphone au profit du Nokia à clapet de ses années collège.
Une relique antédiluvienne, auquel notre digital minimaliste a redonné vie en toquant aux portes des laboratoires du mantra low tech, positionné en faveur d’une durabilité forte des biens techniques : les « Repair Cafés ». Un projet lancé en 2009 à Amsterdam, et qui fait aujourd’hui florès. L’idée ? « Ramener un objet en panne pour essayer de le réparer gratuitement, à l’aide de l’expertise des bénévoles », explique Sonia, responsable d’une des dix-sept antennes parisiennes de l’association Repair Café Paris, qui n’a pas manqué de m’inviter à l’un de ces événements « croulant sous les demandes ». Sympa.

Plutôt que d’installer la dernière appli du moment, rendez-vous au Centre Social le Picoulet (11ème arr.), où l’on s’amuse à démonter les téléphones – et les GAFAM.
VACHE À LAIT
Rendez-vous est pris au Centre Social Le Picoulet (11ème arrondissement), où l’on dissèque dans la bonne humeur des grilles pains, une machiné à thé – et même un singe musical. « Les gens arrivent avec tout et n’importe quoi », s’amuse Mael, en charge de ces ateliers brico’ collaboratifs où « l’on repart avec le sourire, même si la réparation n’a pas abouti ». Tout simplement parce que « les participants sont contents de délaisser quelques heures le virtuel pour profiter d’un moment de partage » autour de pratiques solidaires, irriguées par « une philosophie anti-consumériste ». Et à mon accompagnateur, Melchior, d’abonder en s’exclamant, Nokia vintage brandit bien haut, qu’il y en a « marre d’être les vaches à lait des GAFAM ». Avant de mobiliser la bonne vieille terminologie marxiste : « Si on veut s’émanciper de l’aliénation au numérique qui fait le beurre des Big Tech, il faut que les masses se réapproprient la maîtrise de l’outil technique, ici et maintenant ». La preuve par le verbe que si certains embrassent le digital minimalism pour préserver leur santé mentale, d’autres élargissent sa portée en ouvrant l’horizon d’un rapport plus actif, plus politisé, à la technologie.
« Il y a plusieurs entrées dans les mouvements prônant la déconnexion », atteste Laurence Allard, chercheuse en science de la communication et co-autrice de Écologies du smartphone. « Certains s’engagent dans l’objectif de cultiver individuellement une économie de l’attention plus réfléchie. D’autres le font par souci environnemental, afin de promouvoir la sobriété numérique et défendre les principes de durabilité liés au recyclage, ou à la révision artisanale ». Dans les rangs des digital minimalistes il y a les numérico-soucieux, donc. Et puis les autres. Ceux qui, comme Melchior, envisagent leur transition comme une déclaration de guerre contre l’extractivisme des données personnelles, l’obsolescence programmée et, in fine, l’appétit rapace de l’idéologie capitaliste.
Pour organiser la résistance, Laurence Allard pointe l’existence « de réflexions radicales autour des principes de propriété, et de besoins matériels » menée au sein de micro-communautés où « l’on mutualise les biens techniques, on apprend la maintenance grâce au Do It Yourself (DIY). Et on détermine collectivement ce qui est dispensable, ou non, à l’échelle locale ». Une voie plus technocritique que technophobe, pour esquisser les contours des comportements éthiques de demain, vis-à-vis « de ce nouveau milieu naturel parfois engluant, et souvent périlleux, qu’est le numérique, pour l’humain du XXIème siècle ». En France, ces activistes que l’on augure d’avant-garde s’appellent « décroissants » ou encore « collapsonautes », et s’organisent en réseau via Facebook, où il se murmure que de nouveaux membres seraient les bienvenus. Alors, prêts à devenir des born again du digital ? Nous, on a déjà nos tickets.
Par Antonin Gratien
Photos Arnaud Juhérian