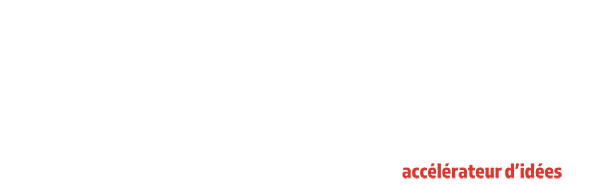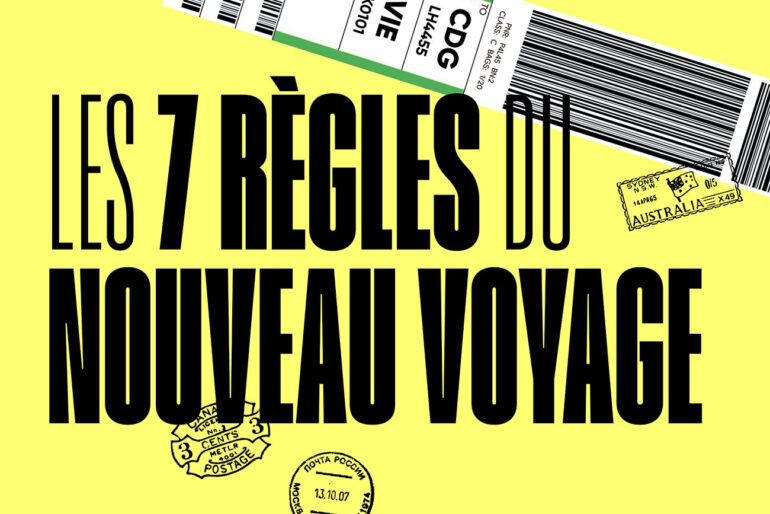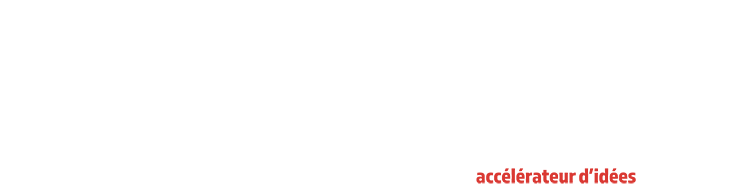Alors que le tourisme mondial a retrouvé son niveau record d’avant Covid, l’appétit des Français pour le voyage n’a pas faibli, il s’est transformé. Plus déconstruit, mais aussi plus auto-centré : voici les sept nouvelles routes du soi.
01. À LA RECHERCHE DE L’AUTRE MOI
« Je voulais me découvrir, me confronter au monde » : parmi la troisième jeunesse (18-25 ans), le voyage solo est une manière d’apprendre à connaître ses limites, s’apprivoiser. Vanter les effets formateurs de l’étranger pour les jeunes date du « Grand Tour », voyage initiatique des descendants de classes dominantes anglos-saxonnes afin de parfaire leur éducation. Mais à l’âge d’or de la psychologie, partir est aussi devenu un moyen commun de grandir émotionnellement parlant. Dans un monde où presque tous les territoires semblent accessibles et visibles, il s’agit bien sûr de découvrir d’autres cultures. Mais à travers cette rencontre, c’est un soi encore inconnu que l’on recherche. Pour Sophie Del Castillo, psychologue familiale, si les mouvements des backpackers « s’apparentent aux errances de la Beat Generation, illustrée dans le célèbre On The Road de Jack Kerouac (1957) ou aux voyages initiatiques inhérents au mouvement hippie », la trajectoire de ses voyageurs solo est surtout personnelle, et parsemée de transgressions. Tuez-moi donc ce père.
02. PARTIR UN JOUR (ET POUR LONGTEMPS)
Les Millennials, qui ont connu l’instauration du programme étudiant Erasmus en 1987 en ont bien conscience : le long terme permet de créer une relation différente au lieu visité. Et on expérimente peut être mieux l’ailleurs en éprouvant un nouveau quotidien. Nicolas Bouvier, écrivain voyageur du XXe siècle, souligne l’importance du temps et de la répétition afin de rapporter quelque chose de son voyage. Dans Chronique Japonaise, il parle de ces deux « touristes françaises » rencontrées dans le « hall du Kyoto hôtel », qui étaient déçues qu’on ne leur ait pas livré « l’âme du Japon », étonnées de ne pas avoir pu acheter ce « produit ». Aujourd’hui, à l’ère du télétravail, le statut informel de digital nomad, proposant de travailler toujours à distance, tout en étant un salarié stable, brille de mille feux. Cette nouvelle relation au temps en voyage permet aussi de rationaliser ses trajets en avion : pour un trip de deux semaines au Maroc, la question de dédier une dizaine de jours à une traversée en bateau ne se pose même pas. À l’inverse, quand Isabel Del Real décide de relier Téhéran en vélo depuis son village breton, elle accepte fatalement d’y accorder un an. « Et au retour, s’est posée la question de la suite, car il était hors de question que je retourne dans un bureau. »
03. EN CHEMIN, SE DÉPASSER
En septembre dernier, Inoxtag, jeune Youtubeur de 22 ans, faisait l’événement avec son vlog/documentaire sur son ascension de l’Everest. Un an plus tard, Le Monde soulignait que parmi les 200 000 vidéos du #randonnée sur TikTok, nombreux étaient ceux citant le jeune homme en inspiration. C’est la partie émergée d’un iceberg constitué de sacs 25L, de pochettes de vélos et de snacks protéinés. Si les communautés autour de la marche, du VTT ou du hiking se sont toujours formées assez organiquement, Internet leur a permis de se diffuser, et surtout d’être plus accessible, même à l’étranger. Aujourd’hui, des applications, comme Warmshower, permettent aux usagers voyageant en vélo de dormir gratuitement chez des hôtes, s’ils s’engagent à accueillir à leur tour d’autres cyclistes chez eux. Choisir le temps long, privilégier la route à la destination sont autant d’actes de résistance racontés par Isabel Del Real dans Plouheran (2024), la bande dessinée tirée de son voyage. « J’avais envie d’être dehors du lever au coucher du soleil et, si possible, d’avancer. »
04. COMMENT SE RACONTER ?
Nos coverstar Seb et Sofyan peuvent en témoigner, le voyage génère un engouement particulier sur les réseaux. Parce qu’une part importante du voyage est l’imaginaire que l’on s’en fait avant de partir. Usant des mêmes mécaniques que les récits d’aventure scientifique du XVIIIe siècle, ces vidéos au fort pouvoir de projection investissent en particulier les plateformes privilégiant les contenus lifestyle comme TikTok et Instagram : entre 2021 et 2025, les contenus « voyage » ont augmenté de 410 %. D’ailleurs, nombreux sont les influenceurs #travel dont les vidéos paradisiaques sont sponsorisées par des compagnies aériennes, hôtelières ou touristiques – Greenpeace les quantifie à 46 % chez les 36 créateurs les plus suivis. Mais cet espace est aussi investi par des comptes qui cherchent à changer les imaginaires liés au tourisme comme celui de Tolt (@Globetolter), ses vidéos « Micros-Aventures autour de Paris » et son média Hourrail!, dédié aux voyages décarbonés. Et le secteur n’est pas réservé aux usagers certifiés. Ainsi, si votre ami qui n’avait jamais touché à une caméra vous annonce « j’ai fait un film sur mon été à Marseille », n’y voyez rien d’exceptionnel. Il est devenu commun de se raconter à grands coups de storys à la une.
05. LE CULTE DE LA HIDDEN GEM
Alors que le voyage est supposé nous faire voir de l’exceptionnel, on se rend compte que notre aventure est fort similaire à celle de ceux qui nous ressemblent. De là, une quête du joyau caché, cristallisé dans le mot clef hidden gem. Une magnifique plage exempte de touristes, un village encore sauvegardé des AirBnB à outrance. Problème : une fois médiatisés, ces lieux ne sont pas cachés pour longtemps. Ce qui était le phénomène « Le Routard » s’est étendu plus largement à l’ensemble des recommandations, que 67 % des utilisateurs de TikTok consultent directement sur l’application. Celles-ci ont aussi eu l’effet secondaire de valoriser un patrimoine accessible, souvent gratuit, et proche des lieux de vies de chacun. Eh non, les gens achetaient rarement d’eux-même le Routard dédié à la Creuse et ses charmantes cascades, tandis que leur algorithme leur déposera peut être sous nez, un beau matin, une vidéo des six randonnées qui y mènent.
06. ÊTRE ACTEUR DU LOCAL
« Je pars en Australie ! À moi les champs d’avocat et la mer ! » Combien de jeunes armés de leurs tout nouveau PVT (Visa Vacances Travail) avez-vous entendu déclarer cela ? Trop. La réponse est trop. D’autant que beaucoup rentrent déçus, confrontés à des conditions de travail très dures et n’étant pas devenus riches comme Crésus. Cherchant une alternative plus responsable, certains se tournent vers des plateformes comme Workaway ou WWOOFING. Là, des fermes, auberges de jeunesse, maisons, ou même bateaux locaux proposent aux volontaires d’être nourri blanchi et logé en échange de quelques heures de travail par jour. Une forme de volontariat à distinguer de certains « voyages humanitaires », proposant d’allier tourisme et aide aux communautés locales, n’ayant que des conséquences négatives sur le terrain. Répétons ensemble : lorsqu’on n’est pas formé pour faire une tâche, il n’y a pas de raison de payer pour venir la faire à la place de quelqu’un d’autre.
07. LA SACRO-SAINTE EXPÉRIENCE
Lorsque l’on part, on laisse derrière nous une grande partie de ce qui nous appartient. Il nous faut donc acheter ce dont on à pas besoin d’habitude : un toît, un espace cuisine, un maillot de bain à paillettes. Mais les vacances sont surtout l’occasion de nous faire acheter une expérience. Un moment dépaysant, vivant, et tant pis s’il est mis en scène. Seulement voilà, pour beaucoup, les vacances ne sont plus ce terrain de liberté, où on s’autorise tout ce qu’on ne fait pas d’habitude et on consomme comme des fous. À présent, elles sont l’occasion d’appliquer nos valeurs, parfois de les mettre à exécution plus intensément que dans la vie de tous les jours. C’est dans le but de procurer cette expérience là, que sont nées des alternatives responsables au auberges de jeunesses usines ou aux Palaces. Sur sa chaîne youtube, le voyageur Karam in the world, parti faire du vélo en Thaïlande, montrait en janvier comment ses deux amis anglais avaient bâti lentement, en lien avec les communautés locales, leur foyer dans les montagnes. Et en France, le compte instagram @decolonial.voyage met en lumière les comportements occidentaux fréquents, pour continuer de détricoter notre rapport à l’ailleurs.
Par Adèle Thiery